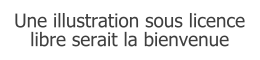Marc-Henry Soulet
Marc-Henry Soulet, né le à Verrières, dans le département de l’Orne en France, est un sociologue français dont les contributions ont concerné la logique de la recherche et de la découverte en sciences sociales et, surtout, l’étude de la « non-intégration », de l'exclusion sociale, de la vulnérabilité et du discrédit identitaire des individus, et l’analyse des mécanismes du travail social et des autres formes d'intervention sociale, y compris du rôle de l'État dans ce domaine.
| Professeur Université de Fribourg |
|---|
| Naissance | |
|---|---|
| Nationalité | |
| Activité |
| A travaillé pour | |
|---|---|
| Membre de |
Biographie
modifierNé le à Verrières, dans le département de l’Orne en France, Marc-Henry Soulet a d’abord enseigné à l'université de Caen. Il a également enseigné à l’Université de Sherbrooke (1980 et 1981), à la Faculty of Arts de Colby College à Waterville, États-Unis (1982 à 1986), à l'Université de Zulia, Venezuela (1988 et 1989), à l'Université de Toulouse-Le Mirail (2000), à l'Université de Łódź (2000), à l'Université de Catane (2004) et à l'Université de Louvain-la-Neuve (2005).
En 2013, il est professeur de sociologie à l'Université de Fribourg en Suisse, où il est titulaire de la Chaire Sociologie, politiques sociales et travail social[1], président du Domaine Sociologie, politiques sociales et travail social et doyen de la Faculté des lettres.
Il est directeur des collections « Res Socialis » et « Lectures du social » de l’Academic Press Fribourg où il a coordonné la publication de nombreux ouvrages sur les problèmes sociaux et l’intervention sociale.
Il est secrétaire général de l'Association internationale des sociologues de langue française et membre de plusieurs comités scientifiques (HES-SO de Lausanne, Université catholique de Lisbonne, Université Nouvelle de Lisbonne). Il est rédacteur en chef de SociologieS, la revue en ligne de l'Association internationale des sociologues de langue française[2],[3],[4].
Premiers travaux
modifierSes travaux à l'université de Caen porteront d'abord sur divers sujets de sociologie : les résidents en foyer de jeunes travailleurs dans la région de Caen[5], les identités collectives, les rapports de sociabilité et la résistance au changement dans les sociétés paysannes, la marginalité ou les intellectuels québécois[6]. En 1993 il copublie avec Vivianne Châtel une étude sur la culture étudiante[7] qui montre l’hétérogénéité des pratiques culturelles des étudiants, avec la « présence simultanée au sein de l’univers estudiantin d’espaces sociaux et culturels hétéroclites, générateurs de pratiques disparates et supportés par des valeurs pour partie divergentes, au sein desquelles les individus se meuvent successivement ou même simultanément »[8].
Logique de la recherche et de la découverte en sciences sociales
modifierSes travaux portent également sur la recherche qualitative en sociologie. Il produit avec Richard Lefrançois un ouvrage sur « Le système de la recherche sociale » en 1983[9], et, avec Robert Castel, une étude sur la structuration d'un milieu de recherche en 1985[10]. Il étudie l’émiettement des recherches sociales[11], le statut de la recherche sociale [12]. En 1999, il traduit l'ouvrage de Joseph A. Maxwell « La modélisation de la recherche qualitative »[13]. En 2004, il traduit et édite l’ouvrage de Anselm Strauss et Juliet Corbin, « Les fondements de la recherche qualitative »[14].
En 2006, il traduit l’ouvrage de Howard Becker, « Le travail sociologique. Théorie et substance »[15]. Il compare la « réflexivité narrative » de Becker à celle du « détective dans le roman à énigme où l’histoire du crime et l’histoire de l’enquête sont disjointes pour mieux éclairer l’une par l’autre »[16].
Il s’intéresse au rôle de l’intuition raisonnée en sciences sociales : dans la lignée de Carlo Ginzburg, qui plaidait pour une « science indiciaire »[17], il propose un « triangle magique de la découverte en sciences sociales » comprenant l’« observation indiciaire », l’« expérimentation logique » et l’« imagination réaliste » [18].
Il s'intéresse enfin aux dilemmes éthiques et aux enjeux scientifiques dans l'enquête de terrain[19].
En 2010, il traduit l’ouvrage de Barney Glaser et Anselm Strauss « La découverte de la théorie ancrée »[20], théorie qui l'amène à se pencher sur le problème de l’interprétation en recherche sociale [21] et sur les qualités requises du chercheur en recherche qualitative, notamment l’« imagination réaliste » et la pratique de la « comparaison-découverte ». Soulet compare le chercheur qualitatif à l’alpiniste qui doit sans cesse assurer ses prises, en lâcher une pour en chercher une nouvelle, la tester, se hisser un peu, et recommencer encore et encore. Le chercheur doit être « réalistement imaginatif », naviguant à la frontière floue entre l'interprétation, respectueuse des données et fidèle au réel investigué, et la sur-interprétation, qui est abus et forçage des données. De plus, s’il n’est pas tombé, l’alpiniste atteint le sommet ; mais pour le chercheur en sciences sociales, il reste à faire reconnaître la plausibilité du résultat obtenu. Il lui faut alors se comporter comme le joueur de puzzle, testant les possibilités d'agencement des pièces par « comparaison-découverte »[22].
Exclusion sociale, vulnérabilité et travail social
modifierMais ses recherches porteront surtout, et à la fois, sur :
- l'exclusion sociale (ou la «non-intégration »), la vulnérabilité des individus, les « identités discréditées », le chômage, etc. et
- les actions dans ce domaine - le travail social et les autres formes d'intervention sociale, dont les efforts de formation, ce qui le conduira à poser le problème du rôle de l'État dans le domaine social.
Non-intégration, exclusion, chômage et dépendances
modifierEn 1989, il coédite un ouvrage sur l'« éclatement du social »[23].
À la suite d'un cycle de conférences publiques à l'Université de Fribourg en 1992-1993, il publiera en 1994 un ouvrage sur la « non-intégration », qu'il considère être « la question sociale de cette fin de siècle »[24].
Il s'intéressera aux liens sociaux et les solidarités, notamment les solidarités familiales[25], aux chômeurs[26], au travail « question sociale de cette fin de siècle »[27], à l'exclusion et aux parcours d’exclusion[28], aux inégalités[29], à la souffrance sociale[30] et à la dépendance aux drogues[31].
Travail social face à la vulnérabilité et à l'exclusion
modifierUn thème récurrent de Marc-Henry Soulet est le couple que forment l'exclusion et la vulnérabilité. Pour lui, le concept de vulnérabilité s’est progressivement substitué à celui d’exclusion, qui servait à rendre compte des phénomènes contemporains de fragilisation et de mise à la marge sociale. L’action publique ne doit pas se contenter de mesures pour les exclus, ou « s’occuper des malades », mais aussi de prévenir l’exclusion parmi les personnes vulnérables, « soigner les bien portants ». Elle doit empêcher les exclus de sombrer plus encore et les aider à « s’en sortir », mais aussi à réduire leur vulnérabilité pour éviter qu’ils ne retombent dans l’exclusion[32]. Ceci l'amène à analyser la nature du travail social en général[33], les fondements de l'intervention sociale[34], les relations entre la solidarité et l’action publique[35] et même la question de la « solidarité planétaire »[36].
Cadre d’action pour le travail social : l’« agir poïétique »
modifierLe travailleur social est confronté à des personnes dont la logique est parfois déroutante (l'individu qui se sait dangereux fait peur aux autres pour les éloigner et les mettre hors de danger), parfois absente (comportement d'autodestruction), presque toujours imprévisible (l'individu fait ou ne fait pas ce qu'il s'est promis de faire)[37]. L’un des apports de Marc-Henry Soulet est le développement d’une typologie de cadres d’action, avec trois cadres typiques :
- L’« agir conforme », quand on a la certitude que l’avenir est stable et prévisible, et qu’on peut se fier à l’« institution totale » : l’action suppose de suivre ses certitudes.
- L’ « agir stratégique », quand l’avenir est relativement incertain, et qu’on peut faire (plus ou moins) confiance à l’« institution instituante » : l’action suppose de jouer avec le risque pour tenter de le contrôler.
- L’« action poïétique », quand on a la certitude que tout est incertain, qu’il vaut mieux se méfier de l’« institution incertaine » : l’action suppose de réduire l’incertitude[38].
Selon lui, l’action poïétique se caractérise par :
- Un déficit de régulation : les règles du jeu ne sont pas claires, les normes sociales ne sont pas cohérentes.
- Une impossibilité à projeter : les individus ont du mal à – ou ne peuvent pas – construire des projections, développer des stratégies, définir des buts précis.
- Une imprévisibilité des effets de l'action engagée.
- Un problème d'appréciation de l'adéquation des ressources à la situation : vu l’incertitude concernant le futur, l’imprévisibilité des résultats, il est difficile d’évaluer les moyens à mettre en œuvre.
La mise en œuvre d’actions poïétiques implique :
- Une construction simultanée des buts et des ressources en cours d'action.
- Une fondation des formes et des principes de légitimation en cours d'action.
- Une démultiplication de la part de l'acteur par exacerbation de sa dimension actionniste
- Une validation mutuelle des actions posées reposant sur des appareils de conversation.
Solidarité de responsabilisation
modifierPour Soulet, les pays développés sont progressivement passés de l’État-providence « versant catégoriellement des prestations à des populations-cible dans l'indistinction des situations particulières », à un État régi par une « solidarité de responsabilisation » qui « donne à chacun les moyens spécifiques qui lui sont nécessaires pour faire face aux aléas de son existence et pour reprendre place au sein de la société », mais « donnant-donnant » : chacun étant responsable et devant « y mettre du sien pour y parvenir »[39]. L’approche est similaire à celle de l’« État social actif » régi par le « solidarisme responsabiliste » de Christian Arnsperger [40] ou l’État responsabilisant (« enabling state ») de Neil Gilbert[41]. Dans chaque cas, « le principe de responsabilité des individus envers la société s’est substitué au principe de solidarité de la société envers ses membres »[42].
Changer de vie, changer sa vie
modifierPour la personne en difficulté sociale, le problème est de « faire face » et de « s'en sortir »[43]. Il est devenu clair pour Soulet que, au niveau individuel, les politiques sociales doivent s'adapter à chaque parcours de vie[44]. Sortir un toxicomane de sa dépendance, c'est « changer sa vie », mais que signifie « changer sa vie » pour le toxicomane[45] ?. Plus généralement, que signifie « changer de vie » ? quels sont les processus engagés[46], quelles sont les propriétés des transitions de statut[47] ?
Notes
modifier- ↑ Chaire comportant, après un cursus commun, une voie « sociologie générale » et une voie « politiques sociales et travail social ». Voir Perret, Michael « Le futur département des sciences sociales, miroir aux alouettes? » [archive]. Spectrum, no 3, mai 2009, p. 6-7. « 3 questions à Marc-Henry Soulet », p. 6-7 ; 3 questions à Maurizio Coppola », p. 6.
- ↑ « Curriculum vitae – Marc-Henry Soulet » [archive], décembre 2008, 28 pp.
- ↑ « Marc-Henry Soulet » [archive], décembre 2009, 4 p.
- ↑ Université de Fribourg « Marc-Henry Soulet » [archive].
- ↑ Dupont & Soulet (1975).
- ↑ Soulet (1987b).
- ↑ Châtel & Soulet (1993).
- ↑ Laceranza Sabine « De nouvelles identités culturelles » [archive] Animafac, 3 septembre 1999, 6 pp. Accès : « Les étudiants et leur identités » [archive]. La même hétérogénéité avait été observée par Lapeyronnie, Didier et Marie, Jean-Louis « Campus blues. Les étudiants face à leurs études », Paris, Le Seuil, Collection : « L’épreuve de faits », 1992, 265 p. (revue [archive]).
- ↑ Lefrançois & Soulet (1983).
- ↑ Soulet & Castel (1985).
- ↑ Soulet (1987a).
- ↑ Soulet (1996c).
- ↑ Maxwell, Joseph A. « La modélisation de la recherche qualitative », Fribourg, Éditions Universitaires, 1999.
- ↑ Strauss, Anselm et Corbin, Juliet « Les fondements de la recherche qualitative », Academic Press, Fribourg, 2004.
- ↑ Becker, Howard « Le travail sociologique. Théorie et substance », Academic Press Fribourg, 2006.
- ↑ Soulet (2005c). Voir Gourbin, Géraldine « Compte-rendu de lecture. Daniel Mercure (Dir.), L’analyse du social. Les modes d’explication » [archive], Sociétés et jeunesses en difficulté, no 5, printemps 2008 [« Parentalité et pratiques socio-éducatives »], mis en ligne le 15 octobre 2009 et Boudjaoui, Mehdi « Comprendre la multidimensionnalité des processus de professionnalisation : les apports de l’observation et de la recherche – action » [archive]. Actes du 2e colloque international francophone sur les méthodes qualitatives, Lille 25- 26 juin 2009, 24 pp., p. 12-13.
- ↑ Ginzburg, Carlo, « Traces. Racines d’un paradigme indiciaire ». p. 139-180 in Ginzburg, C., éd. « Mythes, emblèmes et traces. Morphologie et histoire ». Paris, Flammarion, 1989.
- ↑ Soulet (2006d). On retrouve cette méthodologie de recherche indiciaire dans Thouard, D., éd. (2007). « L’interprétation des indices. Enquête sur le paradigme indiciaire avec Carlo Ginzburg », Villeneuve d’Ascq : Presses Universitaires du Septentrion, 2007.
- ↑ Lalive d’Épinay & Soulet (06-2007).
- ↑ Glaser, Strauss & Soulet, ed. (2010).
- ↑ Soulet (04-2011)
- ↑ Soulet (03-2012). Voir aussi Baribeau, Colette et Royer, Chantal « Quelles qualités essentielles la recherche qualitative requiert-elle de la part du chercheur ? » [archive], Recherches qualitatives, Hors série « Les qualités essentielles du chercheur qualitatif », no 12, 2012, p. 1-8.
- ↑ Le Gall, Martin & Soulet (1989).
- ↑ Soulet, ed. (1994).
- ↑ Soulet, ed. (1996a).
- ↑ In Friboulet, ed. (1997). Soulet, ed. (2006a).
- ↑ Soulet, ed. (1999b).
- ↑ Soulet (2000a & b). Soulet, ed. (2004a).
- ↑ Soulet, ed. (2006a).
- ↑ Soulet, ed. (2007a).
- ↑ Soulet (2002), Soulet (2003a), Soulet (2009b).
- ↑ Châtel & Soulet (2003). Soulet (04-2005, 2005a, 2005b & 2008a). Soulet (2008b) in Châtel & Roy, eds. (2008). Soulet (02-2012).
- ↑ Soulet (1996b) ; Soulet, ed. (1997)
- ↑ Soulet, ed. (1999a), Soulet (2003b).
- ↑ Petrella, Soulet & Longchamp (1997) ; Soulet, ed. (2004b, 2004c, 2005d, 2006e).
- ↑ Soulet, ed. (2007b).
- ↑ Soulet (2005e).
- ↑ Soulet (2004) p. 9. Haenni & Soulet (12-2006) p. 6.
- ↑ Soulet (2005d).
- ↑ Arnsperger, Christian « L’État social actif comme nouveau paradigme de la justice sociale. L’avènement du solidarisme responsabiliste et l’inversion de la solidarité », p. 279-300 in Vielle, P. ; Pochet, P. et Cassiers, I., éds. « L’État social actif. Vers un changement de paradigme ? », Bruxelles, P.I.E.-Peter Lang, 2005.
- ↑ Gilbert, Neil « Transformation of the Welfare State : The Silent Surrender of Public Responsibility », New York, Oxford University Press, 200, p. 43.
- ↑ Voir p. 28-29 in Pégon, Guillaume « Le traitement clinique de la précarité. Collectifs d’intervention, parcours de vulnérabilité, pratique de care. L’exemple du Carrefour Santé Mentale Précarité du département de l’Ain. » [archive] Thèse d’Anthropologie et Sociologie, École doctorale : Sciences Humaines et Sociales, Faculté d’Anthropologie et de Sociologie, Université Lumière Lyon 2, 25 février 2011, 509 pp.
- ↑ Châtel & Henry (2002 a & b).
- ↑ Soulet (2008c)
- ↑ Soulet (2009b).
- ↑ Soulet (2009c) ; Soulet (06-2011) ; Soulet, ed. (2011b). Voir aussi « Cycle de conférences 2008/09 : Changer de vie : un problème social ? » [archive], 3 pp., Lalande, Aude « Changer sa vie. Entretien avec Marc-Henry Soulet » [archive], Vacarme, no 53, automne 2010 et Le Yondre, François « Compte rendu. Marc-Henry Soulet (dir.), Changer de vie. Un problème social » [archive]. Lectures, Les comptes rendus, 2012, mis en ligne le 05 mai 2012.
- ↑ Soulet (05-2012).
Bibliographie
modifierMarc-Henry Soulet est l'auteur de nombreux articles, ainsi que l'auteur, le coauteur ou l'éditeur de plusieurs ouvrages:
- Châtel, Vivianne et Soulet, Marc-Henry (1993) « La culture étudiante, entre mythe et diversité », Paris, Éditions du Ministère de la Culture et de la Francophonie, 1993.
- Châtel, Vivianne et Soulet, Marc-Henry (2002a) « Faire face et s'en sortir. Volume 1, Négociation identitaire et capacité d'action » [archive], Fribourg, Éditions Universitaires, 2002, 578 pp.
- Châtel, Vivianne et Soulet, Marc-Henry (2002b) « Faire face et s'en sortir, Volume 2, Développement des compétences et action collective », Fribourg, Éditions Universitaires, Suisse, 2002.
- Châtel, Vivianne et Soulet, Marc-Henry (2003) « Agir en situation de vulnérabilité » [archive]. Laval, Presses de l'Université Laval, 2003, 214 pp. (ISBN 978-2763780054) Traduction en anglais, “Coping and Pulling through. Action Processes in Vulnerable Situations”, London, Ashgate Publisher, 2004.
- Dupont, Yves et Soulet, Marc-Henry (1975) « La formation professionnelle continue et les résidents en foyer de jeunes travailleurs dans la région caennaise ». Sous la direction de Doris Bensimon, Caen : Université de Caen, Mission formation continue, 1975.
- Friboulet, Jean-Jacques, ed. (1997) (en collaboration avec Sabrina Guidotti, Marc-Henry Soulet, Jean-Claude Simonet et Claudia Sassi) « Scénarios pour une politique en faveur des chômeurs en fin de droit. État des lieux et analyse prospective à partir de l’exemple fribourgeois », Fribourg, Éditions Universitaires, 1997.
- Glaser, Barney ; Strauss, Anselm ; Soulet, Marc-Henry et al. (2010) “La découverte de la théorie ancrée : Stratégies pour la recherche qualitative ». Armand-Colin, 2010, 409 pp.
- Haenni-Emery, Stéphanie et Soulet, Marc-Henry (12-2006) « L'institution incertaine » [archive]. Rhizome, Bulletin national santé mentale et précarité, no 25, [« Réinventer l’institution »], p. 4-7.
- Hunkeler, Thomas et Soulet, Marc-Henry, éds. (2012) « Annie Ernaux. Se mettre en gage pour dire le monde ». MétisPresses, Collection Voltiges, , 220 pp. (ISBN 978-2940406654)
- Lalive d’Épinay, Christian et Soulet, Marc-Henry (06-2007) « Éditorial. Dans la gueule du monstre » [archive]. SociologieS [« Dilemmes éthiques et enjeux scientifiques dans l'enquête de terrain »], .
- Le Gall, Didier ; Martin, Claude et Soulet, Marc-Henry (1989) « L'éclatement du social, crise de l'objet, crise des savoirs ? », Caen, Presses de l'Université de Caen, Centre de recherche sur le travail social, collection « Les frontières du social », 1989, 307 pp. (ISBN 978-2-85480-227-6)
- Lefrançois, Richard et Soulet, Marc-Henry (1989) « Le Système de la recherche sociale. Tome 1 : La recherche sociale dans l'État » [archive], Sherbrooke, Presses de l'Université de Sherbrooke, et Cahiers de la recherche sociale, Université de Caen, 1983, 488 pp. Traduction partielle en espagnol sous le titre « La Institucionalizacion de la Investigacion Social », Maracaibo, Presses de l'Universidad del Zulia, 1989.
- Petrella, Riccardo ; Soulet, Marc-Henry et Longchamp, Albert (1997). « L’État démissionne ? Place au privé ! Les œuvres d’entraide en question : les organisations privées rempliront-elles demain toutes les tâches sociales? » [archive], Lucerne, Éditions Caritas, 1997, 56 pp. Inclut Soulet, Marc Henry « Les Rapports entre solidarité publique et solidarité privée : vases communicants ou coopération conflictuelle ? », p. 28-46.
- Soulet, Marc-Henry (1987a) « Les recherches sociales en miettes », Paris, Éditions du CTNERHI, 1987.
- Soulet, Marc-Henry (1987b) « Le Crépuscule des lumières. Radioscopie de l'intellectuel québécois », Montréal, Éditions Saint-Martin, 1987.
- Soulet, Marc-Henry, ed. (1994) « De la non-intégration. Essais de définition théorique d'un problème social contemporain », Fribourg, Éditions Universitaires, 1994, 168 p. (ISBN 9782827106769). Traduction en portugais « Da não-integração », Coimbra, Quarteto Editora, 2000.
- Soulet, Marc-Henry, ed. (1996a) « Crise du lien social et recomposition des solidarités », Fribourg, Éditions Universitaires, 1996, 313 pp. [Articles sur « Solidarité : La grande transformation » et « Les solidarités familiales : Constances et changements »].
- Soulet, Marc-Henry (1996b) « Petit précis de grammaire indigène de l'intervention sociale », Fribourg, Éditions Universitaires, 1996. Traduction en italien, « Piccolo prontuario di "grammatica" del lavoro sociale. Regole, principe e paradossi dell'intervento sociale nel quotidiano », Napoli, Ligori Editore, 2003.
- Soulet, Marc-Henry (1996c) « La recherche peut-elle être sociale, » Vie Sociale, no 2-3, mars-, p. 37-50.
- Soulet, Marc-Henry, ed. (1997) « Les Transformations des métiers du social », Fribourg, Éditions Universitaires, 1997. (ISBN 9782827107919)
- Soulet, Marc-Henry, ed. (1999a) « Urgence, souffrance, misère : lutte humanitaire ou politique sociale ? », Fribourg, Éditions Universitaires, 1998, 335 pp.
- Soulet, Marc-Henry, ed. (1999b) « Le Travail nouvelle question sociale » [archive], Fribourg, Éditions Universitaires et Imprimerie Saint-Paul, 1999, 389 pp. (ISBN 2-8271-0828-3)
- Soulet, Marc-Henry (2000a) « Parcours d'exclusion : quelques questions impertinentes au raisonnement en forme de continuum animé» [archive] Groupe de travail « Inégalités, identités et liens sociaux», Congrès de Québec, 2000.
- Soulet, Marc-Henry (2000b) « Face a l'exclusion : La résurgence de la topique de la pitié comme fondement de l'intervention sociale » [archive]. Groupe de travail « Inégalités, identités et liens sociaux », Congrès de Québec, 2000.
- Soulet, Marc-Henry (2002) (en collaboration avec Maria Caiata Zufferey et Kerralie Oeuvray). « Gérer sa consommation. Drogues dures et enjeu de conventionnalité ». Fribourg, Éditions Universitaires, Collection « Res socialis », 2002, (ISBN 978-2827109494)
- Soulet, Marc-Henry (2003a) « Comment les intervenants sociaux peuvent-ils faire face aux défis qui s'imposent de plus en plus vite dans un contexte en mutation ? ». p. 9-14 in Dietrich, Nicolas et König, Marianne « Thérapie et méthadone en milieu résidentiel : au carrefour des représentations et des pratiques. Rapport de la journée du 18 novembre 2003 à Bulle » [archive], KOSTE/COSTE, Berne, 2004, 76 pp.
- Soulet, Marc-Henry (2003b) « Penser l’action en contexte d’incertitude : une alternative à la théorisation des pratiques professionnelles ? » [archive] Nouvelles pratiques sociales, vol. 16, no 2, 2003 [« Une pragmatique de la théorie »], p. 125-141.
- Soulet, Marc-Henry (2004a) « Quel avenir pour l'exclusion ? » [archive] , Fribourg, Fribourg Academic Press, Collection Res Socialis, Éditions Saint-Paul, 2004, 188 pp. (ISBN 978-2827109821). Inclut : « Au-delà de l’exclusion », p. 9-16.
- Soulet, Marc-Henry, ed. (2004b) « Agir en société. Engagement et mobilisation aujourd'hui » [archive], Fribourg, Fribourg Academic Press, Collection Res Socialis, Éditions Saint-Paul, 2004. (ISBN 2-8271-0976-X) Inclut « Agir en société : permanence des enjeux et mutations des formes », p. 9-22.
- Soulet, Marc-Henry, ed. (2004c) « La solidarité : exigence morale ou obligation publique » [archive], Fribourg, Fribourg Academic Press, , Collection Res Socialis, Éditions Saint-Paul, 2004, 217 pp.
- Soulet, Marc-Henry (04-2005) « La vulnérabilité comme catégorie paradoxale de l'action publique » [archive]. Contribution à l'ouvrage "La vulnérabilité sociale", , 22 pp.
- Soulet, Marc-Henry (2005a) « La vulnérabilité comme catégorie de l’action publique » [archive]. Pensée plurielle, 2005/2, no 10, p. 49-59.
- Soulet, Marc-Henry (2005b) « Reconsidérer la vulnérabilité » [archive]. Empan, 2004/5, no 60, 2005, p. 24-29 (version html [archive]). Ciclo Conferências Mestrado Serviço Social 2008/09 [archive], p. 5-11.
- Soulet, Marc-Henry (2005c) « L’angle mort de la logique de la découverte chez Howard S. Becker », p. 75-79 in Mercure, Daniel, ed. (2005) « L’analyse du social. Les modes d’explication. » Presses de l'université Laval, Collection « Sociologie contemporaine », , xv + 329 pp. (ISBN 2-7637-8103-9)
- Soulet, Marc-Henry (2005d) « Une solidarité de responsabilisation » [archive], dans Ion, J., (2005), « Le travail social en débat(s) », Paris, Éditions La Découverte, p. 86-103.
- Soulet, Marc-Henry (2005e). « Confiance et capacité d’action. Agir en contexte d’inquiétude ». p. 31-55 in Balsa, Casimiro, éd. (2005). « Confiance et lien social » [archive]. Academic Press Fribourg, Collection « Res socialis » / Éditions Saint-Paul, Fribourg, 2005, 344 pp.
- Soulet, Marc-Henry, ed. (2006a) « Chômage et solidarité : les nouvelles inégalités » [archive], Fribourg, Fribourg, Academic Press / Éditions Saint-Paul, 2005, 178 pp. (ISBN 978-2-8271-0833-6). Inclut « La transformation des inégalités. Changement de réalité et modifications des représentations »] p. 9-16.
- Soulet, Marc-Henry, ed. (2006b) « Société en changement – Société de changement » [archive], Fribourg, Academic Press et Éditions Saint-Paul, 2006, 144 pp. (ISBN 978-2-8271-1009-4). Inclut « Le sens du changement » p. 9-14.
- Soulet, Marc-Henry (2006c) « Être(s) en société: visions de l'homme et sociologie(s) » in Bassand, M. et Lalive d'Epinay, C., « Des sociologues et la philosophie », Fribourg, Academic Press Fribourg, 2006.
- Soulet, Marc-Henry (2006d) « Traces et intuition raisonnée. Le paradigme indiciaire et la logique de la découverte en sciences sociales » in Paillé P., éd., « La méthodologie qualitative. Posture de recherche et travail de terrain », Paris, Éditions Armand Colin, 2006.
- Soulet, Marc-Henry (2006e). "Altruism", “Collective action”, “Individualism”, Social solidarity”, “Insider-outsider” in Fitzpatrick, Tony; Kwon Huck-ju; Manning, Nick; Midgley, James and Pascall, Gillian, eds. “International Encyclopedia of Social Policy”, London, Routledge, 2006, 3 volumes.
- Soulet, Marc-Henry, ed. (2007a) « Souffrance sociale. Nouveau malaise dans la civilisation [archive], Fribourg, Academic Press Fribourg, 2007, 204 pp.
- Soulet, Marc-Henry, ed. (2007b) « La solidarité à l'ère de la globalisation » [archive], Fribourg, Academic Press Fribourg et Éditions Saint-Paul, 2007, 136 pp. (ISBN 978-2-8271-1035-3)
- Soulet, Marc-Henry, (2008a) « De l’habilitation au maintien. Les deux figures contemporaines du travail social » [archive]. Savoirs, no 18,2008/3 [« La dimension formative du travail social »], p. 33-44.
- Soulet, Marc-Henry (2008b) « La vulnérabilité : un problème social paradoxal ». Ch.4, p. 65-92 in Châtel, Vivianne et Roy, Shirley, eds. (2008). « Penser la vulnérabilité. Visages de la fragilisation du social ». Presses de l’Université du Québec, Collection « Problèmes sociaux. Interventions sociales », 2008.
- Soulet, Marc-Henry (2008c) « Vers une nécessaire individualisation des politiques sociales ? » in Vrancken D. et Thomsin L., éds. « Le social à l’épreuve des parcours de vie », Bruxelles, Academia Bruylant.
- Soulet, Marc-Henry (2009a) « La vulnérabilité : un problème social paradoxal » [archive]. Contribution à l'ouvrage "La vulnérabilité sociale", . Journées COROMA, 2009, 18 pp.
- Soulet, Marc-Henry (2009b) « Drogues et conventionnalité : un ménage commun ? » [archive]. Psychotropes 2009/4 (Vol. 15, No. 4, 2009, p. 63-69 (version html [archive]).
- Soulet, Marc-Henry (2009c) « Changer de vie, devenir autre : essai de formalisation des processus engagés ». Ch.16, p. 273-288 in Grossetti, Michel ; Bessin, Marc et Bidart, Claire, eds. « Bifurcations. Les sciences sociales face aux ruptures et à l'événement ». La Découverte, « Recherches », 2009, 402 pp. (ISBN 9782707156006)
- Soulet, Marc-Henry (12a-2010) « Frontières sociales, frontières culturelles, frontières techniques » [archive]. SociologieS, .
- Soulet, Marc-Henry (12b-2010) « Lectures croisées des figures contemporaines de l'État social » [archive]. SociologieS, [« Débats : Figures contemporaines de l'État social »], .
- Soulet, Marc-Henry (04-2011) « Interpréter, avez-vous dit ! » [archive]. SociologieS [« Expériences de recherche : Régimes d’explication en sociologie »], .
- Soulet, Marc-Henry (06-2011) « Changer sa vie : une question sociologique » [archive], Sciences Humaines, Les grands dossiers, no 23 « Apprendre à vivre », juin-juillet-.
- Soulet, Marc-Henry (10a-2011) « Les jeux d'échelle des inégalités » [archive], SociologieS [« Débats : Penser les inégalités »], .
- Soulet, Marc-Henry (10b-2011) « Effet de cycle, effet de contexte ou brèche analytique » [archive]. SociologieS, [« Débats : Le naturalisme social »], .
- Soulet, Marc-Henry, ed. (2011a) « Ces gens-là. Les sciences sociales face au peuple », Fribourg, Academic Press Fribourg, coll. « Res Socialis », 2011, (ISBN 9782827110667).
- Soulet, Marc-Henry, ed. (2011b) « Changer de vie. Un problème social », Fribourg, Academic Press Fribourg, coll. « Res Socialis », 2011, 152 p. (ISBN 9782827110681).
- Soulet, Marc-Henry (02-2012) « Vulnérabilité : les raisons d’un succès ». Conférence publique, Université de Fribourg, (résumé [archive])).
- Soulet, Marc-Henry (03-2012) « Interpréter sous contrainte ou le chercheur face à ses données » [archive]. Recherches qualitatives, Hors série « Les qualités essentielles du chercheur qualitatif », no 12, , p. 29-39.
- Soulet, Marc-Henry (05-2012) « Présentation du Chapitre 1 « Les transitions statutaires et leurs propriétés » [archive] du livre de Barney G. Glaser et Anselm L. Strauss, Status Passage : A Formal Theory, Chicago, Aldine-Atherton, 1971 », SociologieS, .
- Soulet, Marc-Henry et Castel, Robert (1985) « Secteur social et recherche universitaire : rapport de mission sur la structuration d'un milieu de recherche à partir des troisièmes cycles universitaires demandé par la Mission recherche expérimentation et la Sous-direction des professions sociales et du travail social du Ministère des Affaires sociales ». Paris, MIRE, 1985, 129 p.
Liens externes
modifier
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :